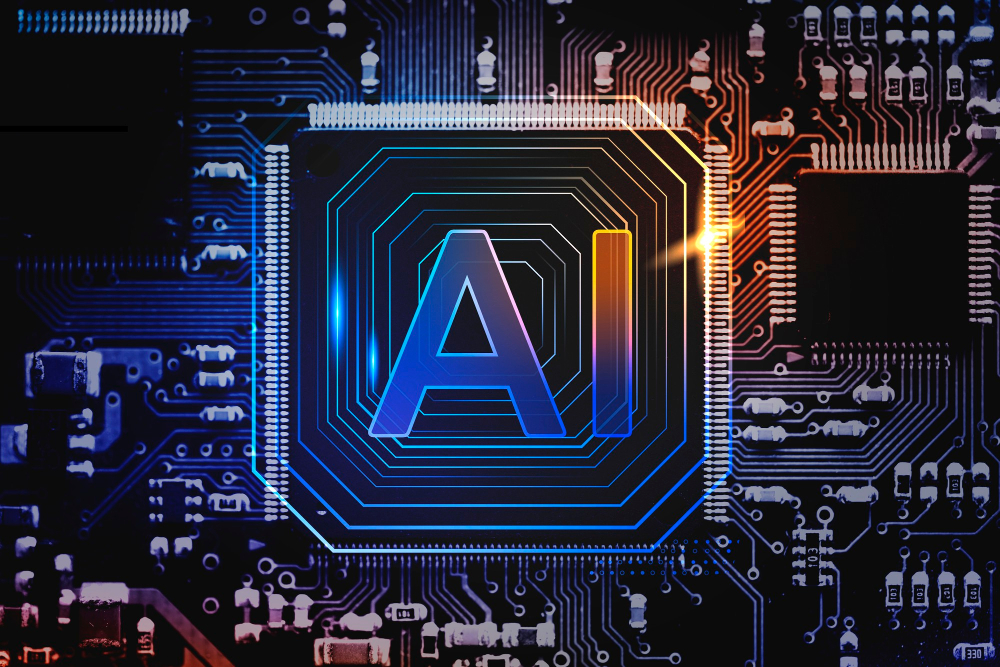Le 15 avril 2025, la chambre basse du parlement ouzbek a approuvé en première lecture un projet de loi visant à encadrer l’usage de l’intelligence artificielle (IA). Dans un contexte mondial de course technologique effrénée, l’Ouzbékistan s’engage à son tour dans la régulation de ces outils, sans pour autant calquer le modèle européen. Une démarche singulière, entre gestion des dérives numériques et volonté assumée de ne pas freiner l’innovation.
L’intelligence artificielle : promesse économique et défi social en Ouzbékistan
Dans l’hémicycle ouzbek, l’intelligence artificielle n’est plus un simple sujet prospectif, mais bien une priorité législative. À l’ouverture des débats, la députée Shahnoza Kholmakhmatova a dressé un panorama chiffré sans appel : « En 2023, le secteur de l’IA a reçu 154 milliards de dollars d’investissements. En 2024, ce chiffre a doublé. D’ici 2030, il pourrait être multiplié par dix ». En filigrane, l’Ouzbékistan ne veut pas rater le coche.
Et pourtant, le pays est déjà confronté à des dérives en la matière. En 2023, les autorités ont recensé 1.129 cas de diffusion de contenus manipulés par IA. Un an plus tard, ce chiffre bondit à 3.553. Falsifications d’images, voix synthétisées, usurpation d’identité numérique : « L’IA a été utilisée pour créer de fausses vidéos de personnalités afin de gagner la confiance du public ». Une réalité qui justifie, selon les députés, l’adoption urgente d’un cadre juridique.
Encadrer l’intelligence artificielle sans la museler : un pari assumé
Contrairement à l’Union européenne qui a choisi de créer une agence de supervision dédiée à l’IA, l’Ouzbékistan s’y refuse. « Le projet de loi ne prévoit pas de nouvel organe de contrôle. Aucun institut n’est chargé de surveiller spécifiquement les relations liées à l’usage de l’intelligence artificielle », a déclaré Ilkhom Abdullaev, président de la commission parlementaire sur l’innovation.
Le texte pose les premiers jalons réglementaires : définition légale de l’IA, principes d’usage, encadrement du traitement des données personnelles, interdiction de décisions basées exclusivement sur des systèmes automatisés. Il impose surtout une mesure phare : la signalisation obligatoire de tout contenu produit par une IA. Objectif : transparence. La Chine a déjà instauré une obligation similaire, rappelée dans les débats comme une référence pragmatique.
Et pourtant, Ilkhom Abdullaev insiste : « Ce n’est pas une loi restrictive. Nous introduisons seulement les règles du jeu dans le champ juridique ». Une façon de dire que le texte vise la pédagogie plus que la répression. Pour preuve, les modalités de mise en œuvre seront précisées dans des règlements secondaires, encore à rédiger.
Entre stratégie nationale et absence de surveillance centralisée
L’adoption de cette loi s’intègre dans une stratégie nationale plus vaste, intitulée « Stratégie pour le développement des technologies d’intelligence artificielle jusqu’en 2030 ». Adoptée en octobre 2024, cette feuille de route ambitionne d’intégrer l’IA dans tous les segments de l’économie ouzbèke – de la santé à l’agriculture – tout en formant 3.000 fonctionnaires et en créant plusieurs laboratoires universitaires spécialisés.
À ce jour, plus de 20 projets d’intelligence artificielle ont déjà été mis en œuvre dans le pays, et 70 autres sont en cours de développement. Un dynamisme qui tranche avec l’absence de véritable autorité de régulation. Un choix qui interroge : comment garantir un usage éthique et sécurisé de l’IA sans organe dédié à cette fin ?
Le député Azizbek Akbarov a d’ailleurs appelé à étendre la responsabilité juridique en cas d’usage de l’IA portant atteinte non seulement à la vie privée, mais aussi à « l’image de la nation ou aux figures historiques du pays ». Une proposition révélatrice d’une inquiétude croissante autour de l’usage des technologies pour manipuler la mémoire collective.