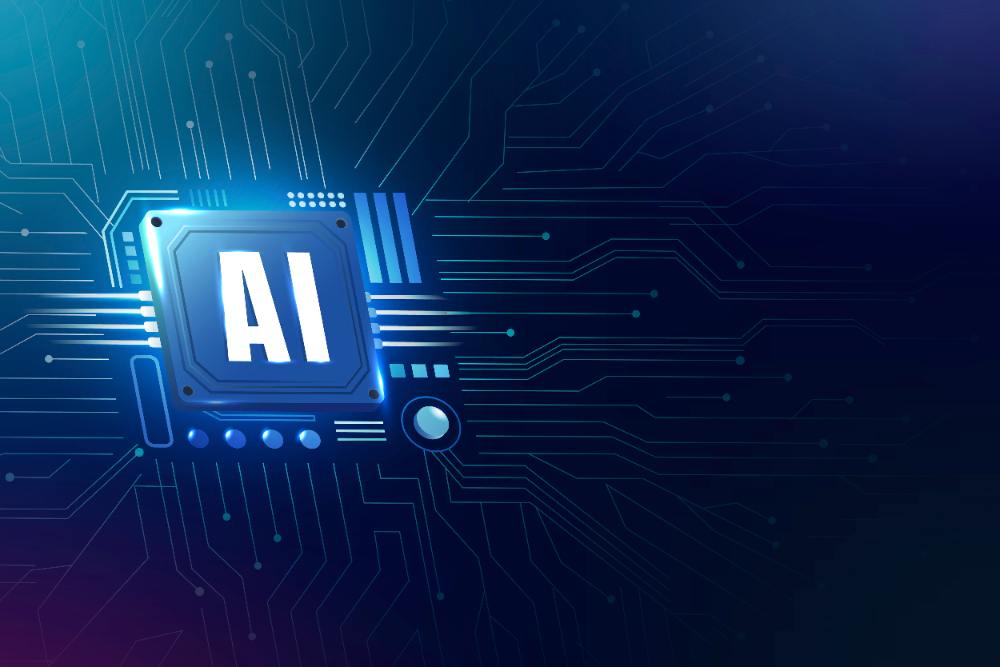Les autorités kazakhstanaises viennent de dévoiler un programme d’envergure : former un million de citoyens à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). Une annonce fracassante qui s’inscrit dans un contexte mondial de course à la maîtrise des technologies de rupture.
Former à l’IA, une urgence numérique ?
Ce projet, porté tambour battant par le Parc des technologies innovantes, vise à « créer une nouvelle génération qui produira davantage grâce aux nouvelles technologies qu’elle ne consommera », selon Daniya Akhmetova, sa directrice générale. Objectif affiché : toucher un million de profils hétérogènes – élèves, étudiants, entrepreneurs, fonctionnaires – dans les cinq prochaines années. Mais pourquoi ce chiffre ? Pourquoi maintenant ? Et surtout, qui bénéficiera réellement de cette formation à l’IA censée faire du Kazakhstan un hub technologique ?
Ce chiffre, délibérément symbolique, résonne plus comme une promesse politique que comme une donnée opérationnelle. Dans un pays où les infrastructures éducatives restent inégalement réparties, atteindre une telle envergure nécessiterait une logistique nationale millimétrée – et des financements colossaux.
L’usine à codeurs « made in Kazakhstan »
Concrètement, le programme repose sur deux dispositifs phares. D’abord, l’ouverture à l’automne 2025 d’un centre TUMO pour les adolescents de 12 à 18 ans. Inspiré du modèle arménien, ce centre offrira gratuitement des cours de programmation, de graphisme 3D et d’intelligence artificielle. Une initiative séduisante, certes, mais dont la portée reste limitée à une frange urbaine.
Ensuite, pour les étudiants, une première école dédiée à l’IA – Tomorrow School – a été lancée en 2024 sur un modèle peer-to-peer, sans professeur mais avec apprentissage par les pairs. L’inscription est gratuite, la durée fixée à deux ans, mais les candidats doivent passer une sélection rigoureuse. L’approche inclut aussi du travail en équipe et le développement de la pensée critique.
IA pour tous ou IA pour quelques-uns ?
Un point reste opaque : la répartition territoriale du dispositif. Si l’on forme massivement dans les grandes villes comme Astana ou Almaty, qu’en est-il des régions rurales ? Le plan inclut-il des infrastructures mobiles, des plateformes accessibles sans haut débit, une stratégie multilingue (kazakh, russe, anglais) ? Rien de cela n’est précisé.
Lors de la présentation d’un projet de loi sur la régulation de l’intelligence artificielle en mars 2025, la députée Ekaterina Smyshlyaeva avait même alerté sur un risque de dérive cognitive. Selon elle, « les recherches démontrent que l’usage fréquent de l’IA entraîne une baisse des capacités à penser et à analyser. Cela pourrait devenir une menace pour la pensée des enfants ».
Éducation, mais pour quelle IA ?
La formation proposée semble se concentrer sur des compétences pratiques : codage, traitement de données, design. Mais aucun élément ne laisse entrevoir un volet éthique, sociologique ou juridique. Or, former un peuple à l’intelligence artificielle sans le sensibiliser à ses dangers, c’est livrer des outils puissants sans boussole morale.
Le programme ne dit rien non plus des partenariats internationaux, ni de la certification des compétences acquises. Quelle reconnaissance ces formations auront-elles à l’étranger ? Y aura-t-il une équivalence académique ou professionnelle ? Pas de réponses pour l’instant.